Qu’est-ce que le capitalisme ? Sur quelle infrastructure technique repose le système capitaliste ? Qui a créé les euros que nous utilisons dans notre quotidien ? Testez vos connaissances en Économie à l’aide de notre quiz ci-dessous :
↧
Réponses du quiz
Bonne réponse : À la généralisation du prêt à intérêt.
Mauvaises réponses : À l’invention du concept de propriété privée ; à l’efficacité de l’exploitation de l’Homme par l’Homme.
Explication : Nombre d’économistes font remonter le capitalisme à la découverte de l’Amérique (XVe siècle), période où l’on a commencé à pleinement tolérer le prêt à intérêt, jusqu’alors interdit par la religion et qualifié d’usure. Afin de financer des expéditions maritimes très coûteuses, mais potentiellement rentables pour l’emprunteur (et par suite le prêteur), les grandes fortunes ont peu à peu pu prêter à intérêt leur argent, sans que cela soit mal vu.
Ceci dit, certains font débuter le capitalisme avec le mouvement des enclosures (XVIe siècle) ou la révolution industrielle (XIXe siècle) et la propriété privée des moyens de production. D’autres estiment que capitalisme rime avec protestantisme (XVIe siècle), qui a permis aux riches de ne plus être considérés comme de mauvais chrétiens (l’enrichissement est le signe d’une approbation divine pour les protestants). L’exploitation de l’Homme par l’Homme existait en revanche bien avant le capitalisme.
Bonne réponse : À un système économique plaçant les investisseurs au coeur de son fonctionnement.
Mauvaises réponses : À rien de concret, c’est une idéologie ambiante qui pousse à la surconsommation. ; à un système politique, dont la valeur cardinale est la liberté d’entreprendre.
Explication : Le capitalisme a eu le mérite de résoudre les crises économiques dues à une “aporie monétaire”, à savoir que la fonction de réserve de valeur de la monnaie (on en met de côté) s’opposait à sa fonction d’intermédiaire des échanges (on la dépense). Réinjecter l’épargne dans l’économie en la prêtant à intérêt, a été la réponse capitaliste à cette fâcheuse contradiction monétaire. Le capitalisme est ainsi une organisation de la circulation monétaire centrée autour de l’investissement.
Le libéralisme économique milite à l’origine pour un libre marché, un certain laissez-faire économique, tandis que l’ultralibéralisme reposent sur l’idée que la quête de profits est la meilleure conseillère qui soit pour guider l’économie. En effet, si quelque chose rapporte, c’est que des gens achètent et donc qu’ils sont contents. Les intérêts privés des capitalistes seraient ainsi alignés avec l’intérêt général, et il reviendrait à la cupidité d’orienter notre développement économique.
Bonne réponse : Le système bancaire et financier, qui crée et administre nos moyens de paiement.
Mauvaises réponses : La République, au travers du droit (pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire) ; Les cabinets d’audit comptable, qui prouvent la rentabilité des entreprises.
Explication : L’organisation économique capitaliste repose essentiellement sur un système monétaire (les institutions qui gèrent la circulation de la monnaie). Sans cette infrastructure, le capitalisme ne pourrait pas concrètement fonctionner. Au fondement du capitalisme se trouve en définitive le système bancaire et financier permettant à l’épargne de rapporter, à l’argent d’être investi. Touchez à ce système, c’est modifier en profondeur le capitalisme.
Certes, le capitalisme a également besoin de l’État et de la comptabilité pour bien fonctionner, mais ce sont des « surcouches ». Ces « surcouches » peuvent encadrer ou réorienter à la marge le capitalisme. Tant que la quête de profits sera le principal moteur de l’économie, notre organisation économique capitaliste sera de nature ultralibérale. Changer telle loi ou telle règle de comptabilité sans faire évoluer le fonctionnement du système monétaire, s’appelle le réformisme.
Bonne réponse : La croissance économique, car nos investissements doivent rapporter.
Mauvaises réponses : La compétition, car il y a toujours des concurrents pour contester un marché ; le libre marché, car sinon l’État entrave le commerce et l’innovation.
Explication : Le capitalisme est souvent associé au libre marché et à la concurrence. Or, ces derniers tirent les prix vers le bas, là où un monopole tire les prix et donc les marges vers le haut. En réalité, les capitalistes ne sont jamais contre une augmentation de leurs profits et libre marché / mise en concurrence leur sont plutôt imposés par l’État (d’où parfois certaines velléités de laissez-faire, de dérégulation et de dérèglementation, telles qu’avec le néolibéralisme).
Bref, c’est en effet la croissance économique qui est une conséquence logique du capitalisme. La monnaie y étant principalement utilisée comme un capital (à savoir toute chose dont on peut tirer des revenus sans travailler), l’épargne doit rapporter et donc croître. Notre obsession pour la croissance économique découle ainsi du fait qu’elle est très utile pour que la majorité des investissements de nos institutions financières s’avèrent effectivement profitables.
Bonne réponse : En déprivatisant un tant soit peu notre système monétaire.
Mauvaises réponses : En consommant moins et mieux. ; en votant pour le bon président de la République.
Explication : La privatisation de la monnaie est à la genèse du capitalisme. En effet, il est né en réponse à l’accumulation et à la thésaurisation de la monnaie dans les mains des grandes fortunes, qu’il a “fallu” faire évoluer en investisseurs (afin de réinjecter dans l’économie la monnaie accaparée). Depuis la fin du financement direct, nos États n’ont plus le droit de créer la monnaie et l’on peut considérer que notre système monétaire a été totalement privatisé.
De fait, peu importe pour qui nous votons, tant que la monnaie qui circule dans l’économie nous est prêtée à intérêt, notre économie sera essentiellement capitaliste. Par exemple, une banque qui octroie un crédit à une entreprise ou un ménage, investit dans une pure logique capitaliste (elle veut faire de l’argent avec de l’argent). Transformer le capitalisme, c’est donc nous émanciper un tant soit peu de ceux qui ont privatisé la monnaie et qui nous la prêtent dans un but lucratif.
« C’est pour bien montrer qu’il ne pouvait y avoir une économie de gauche et une économie de droite […] que les économistes du XIXe siècle adoptèrent l’expression de “science économique”. »
Jean-Marc Daniel, 3 controverses de la pensée économique.
« Je n’aime pas beaucoup l’expression « science économique », […] qui pourrait faire croire que l’économie aurait atteint une scientificité supérieure, spécifique, distincte de celle des autres sciences sociales. Je préfère nettement l’expression « économie politique », […] qui a le mérite d’illustrer ce qui me paraît être la seule spécificité acceptable de l’économie au sein des sciences sociales, à savoir la visée politique […]. »
Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle.
Bonne réponse : Lors d’un prêt, on prête de l’argent qui existait déjà, tandis que lors d’un crédit, l’argent prêté a été spécialement créé pour être prêté.
Mauvaises réponses : Un prêt est consenti sans garantie, alors qu’un crédit est systématiquement gagé par une hypothèque ; Si l’on prête son propre argent c’est un prêt, si l’on prête l’argent d’un autre c’est un crédit.
Explication : Lors d’une opération de crédit, les euros qu’une banque commerciale prête ont été spécialement créés afin d’être prêtés à intérêt à l’agent économique désirant s’endetter (on parle de création monétaire par le crédit, ou encore de monnaies-dettes ; on dit que les banques monétisent nos dettes). Toujours est-il que ces euros n’existaient pas avant que l’opération de crédit n’ait lieu. À l’inverse, lors d’une opération de prêt, on prête des euros qui existaient d’ores et déjà.
Dit autrement, les monnaies-dettes sont adossées à un actif financier (généralement un titre de dette, et sont quoi qu’il arrive empruntées au système financier), par opposition aux monnaies-or adossées à un certains poids d’or. Là où il fallait trouver de l’or pour pouvoir créer plus de monnaie-or, avec les monnaies-dettes, il suffit qu’un agent économique (un particulier, une entreprise ou une administration) s’endette auprès du système bancaire et financier pour que celui-ci en crée.
Bonne réponse : Les banques commerciales, intermédiaires privés à qui nous les empruntons.
Mauvaises réponses : Les États de l’Union Européenne, qui ont ce qu’on appelle un privilège régalien ; les banques centrales, qui sont indépendantes des États et donc à l’abri des dérives de la démocratie.
Explication : S’il fallait autrefois trouver de l’or pour que l’État puisse créer de la monnaie-or, il suffit au système bancaire de monétiser une reconnaissance de dette (aussi appelée “actif financier”) pour émettre de la monnaie-dettes. On parle de création monétaire par le crédit bancaire. Les euros n’apparaissent donc jamais par enchantement dans l’économie, ils sont le résultat d’un crédit bancaire ou de tout autre institution financière ayant monétisé une dette.
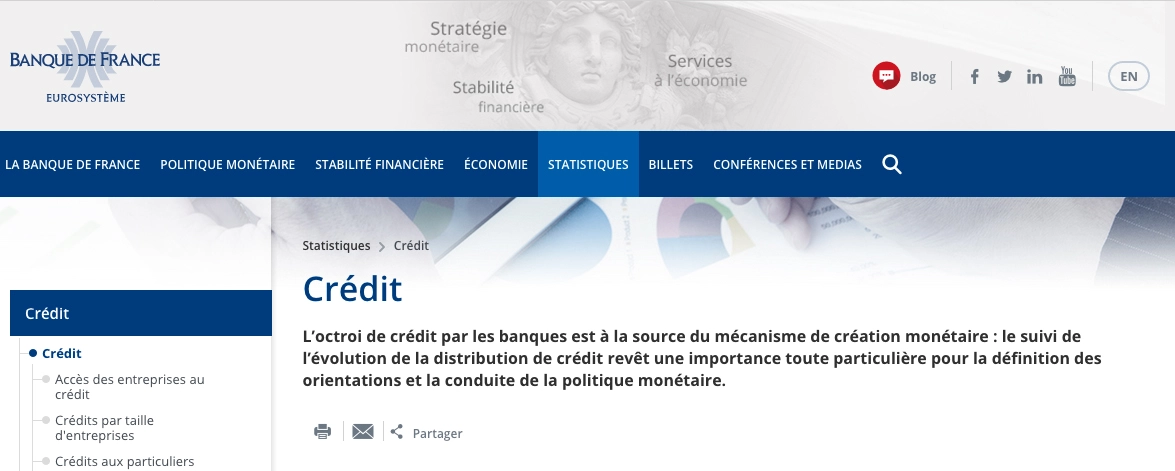
Dit autrement, l’État ne peut pas créer d’euros, il lève l’impôt ou s’endette pour en obtenir. Quant aux banques centrales, elles créent de la monnaie centrale, or la monnaie centrale scripturale (i.e. ce qui exclut les pièces et les billets) est uniquement utilisée par les banques commerciales entre elles. Bref, les euros qu’une entreprise verse sur un compte sont obligatoirement apparus suite à l’endettement d’une administration, d’un ménage ou d’une entreprise.
Bonne réponse : Qu’une banque commerciale ne détient pas l’intégralité de l’argent de ses clients.
Mauvaises réponses : Que seules les banques commerciales peuvent injecter des euros dans l’économie, pas les États ; qu’une banque doit placer une fraction de son bilan dans le Fonds de garantie des dépôts.
Explication : Un système à réserves fractionnaires signifie qu’une banque commerciale peut prêter plus d’argent qu’elle n’en dispose réellement à la banque centrale. En effet, une banque commerciale peut émettre sa propre monnaie, la monnaie bancaire (ou monnaie de crédit bancaire, ou encore monnaie-dettes). Ces euros sont dématérialisés, ils n’ont pas de réalité tangible. Si votre banque fait faillite, votre argent disparaît avec elle.
Voilà pourquoi il existe un Fonds de garantie des dépôts (constitué par l’État), afin de tempérer la méfiance légitime vis-à-vis de ces monnaies-dettes qui peuvent se volatiliser. Quant au fait que le Traité de Lisbonne oblige les États européens à emprunter auprès des marchés financiers plutôt qu’auprès de leur banque centrale (article 123), cela relève de la fin du financement direct ; rien à voir avec les réserves obligatoires des banques (cf. lettre d’information de la Banque de France).
Bonne réponse : Parce que cela incite à l’épargne, ce qui rend le système bancaire plus solide.
Mauvaises réponses : Pour ennuyer les banques concurrentes ; parce qu’elle prête leur argent et qu’elle leur doit donc une rétribution.
Explication : Lorsque l’on prête quelque chose, nous nous séparons pour un temps de la chose prêtée. Or, notre épargne ne semble pas quitter notre compte bancaire. Techniquement, un compte indique simplement la quantité d’euros que nous doit la banque, ce qu’elle s’engage à nous reverser si l’on le lui demande. Les euros “sur” un livret A ne sont en fait rien de plus qu’une dette de la banque envers son client, et voilà pourquoi ils peuvent disparaître si notre banque fait faillite.
En clair, une banque ne prête pas l’argent de ses clients (d’où la différence entre crédit et prêt, cf. question 7/ plus haut). Il apparaît dès lors que rémunérer l’épargne est un moyen de rendre plus stable un système bancaire basé sur le crédit bancaire, car cela incite les clients de la banque à laisser leur argent en banque, c’est-à-dire à ne pas le retirer ni le dépenser (car suite à un paiement par CB, la banque de l’acheteur peut être amenée à envoyer de la monnaie centrale à la banque du vendeur).
Bonus : Pour faciliter la compréhension du rôle de la rémunération de l’épargne dans la stabilisation du système bancaire, nous avons imaginé la « Fable de l’Orfèvre » (cliquer sur le lien pour la consulter ou la télécharger).
Bonne réponse : Parce que le crédit permet de mieux ajuster l’offre de monnaie à la demande.
Mauvaises réponses : Parce que le crédit encourage une société de consommation responsable ; parce que le crédit permet d’emprunter l’argent à des taux négatifs.
Explication : Si nous avons abandonné la monnaie-or plus d’une fois, c’est pour de bonnes raisons. Dans une économie mondialisée en pleine expansion, l’offre de monnaie-or était totalement insuffisante pour satisfaire la demande de monnaie croissante de l’économie. À l’inverse, le crédit est une excellente façon de créer la monnaie, car cela évite de créer en amont une masse de monnaie déconnectée des besoins des agents économiques (entreprises, ménages, administrations).
Avec le crédit, la monnaie est injectée dans l’économie pour répondre à un besoin, puis une fois ce besoin satisfait, elle est retirée de l’économie au fur et à mesure du remboursement du crédit. Si le crédit bancaire encourage effectivement la consommation, celle-ci n’est pas forcément responsable. Enfin, aucun ménage ni aucune entreprise n’emprunte à des taux négatifs ; on parle de coût de l’argent, car la monnaie ne nous est pas « louée » gratuitement par le système capitaliste.
↧
Conclusion du quiz
Comme son nom l’indique, au cœur du capitalisme se trouvent les apporteurs de capitaux ; nous ne guidons pas la vie économique, ce sont les perspectives de gains qui la dirige ; le capital ne travaille plus pour nous, c’est lui qui nous emploie.
Hélas, nous sommes encore trop nombreux à croire que le capitalisme est le pire système économique à l’exception de tous les autres, c’est-à-dire que bien qu’imparfait, il serait vain d’espérer une organisation économique autre que capitaliste.
Notre manque d’imagination nous limite à l’opposition entre capitalisme et communisme, comme si l’économie était condamnée à être essentiellement dirigée par le Marché (p.e. capitalisme néolibérale) ou par l’État (p.e. communisme totalitaire).
En réalité, avec le développement de l’informatique, de nouvelles possibilités s’offrent à nous. Et si le capitalisme n’était bel et bien qu’une étape ? Même en matière d’économie, nous pouvons continuer à innover voire évoluer.
De nos jours le capital ne travaille plus pour nous,
c’est nous qui travaillons pour le capital.
